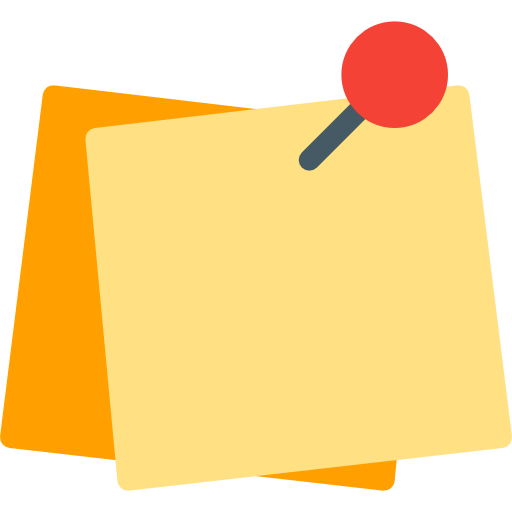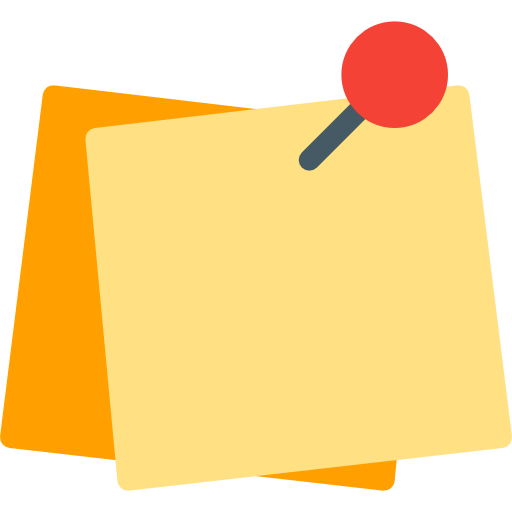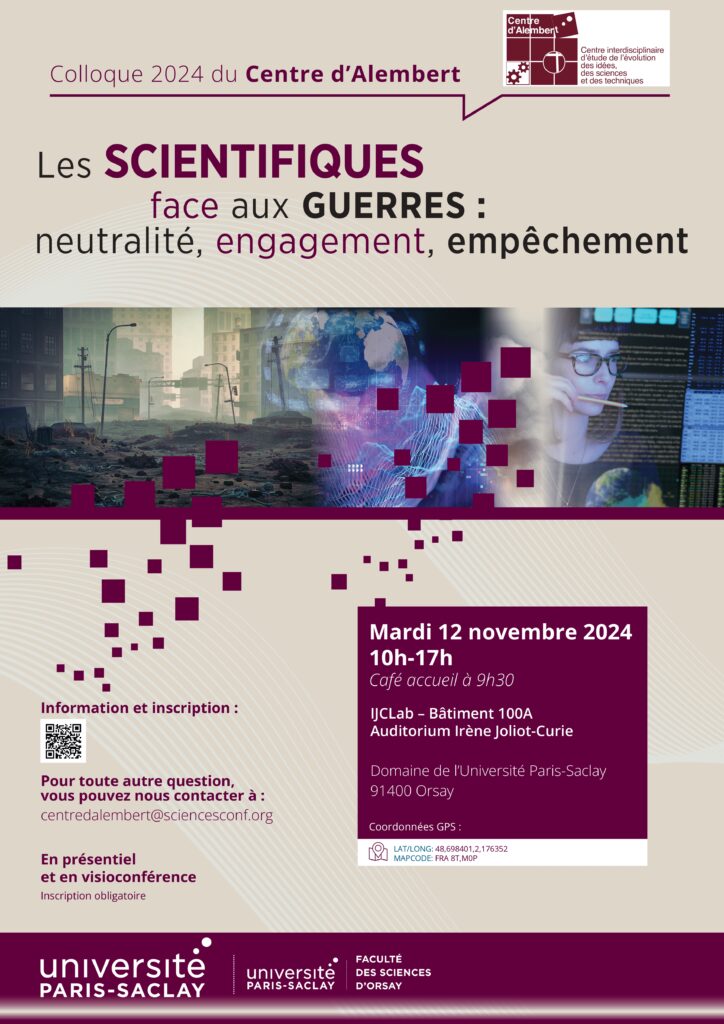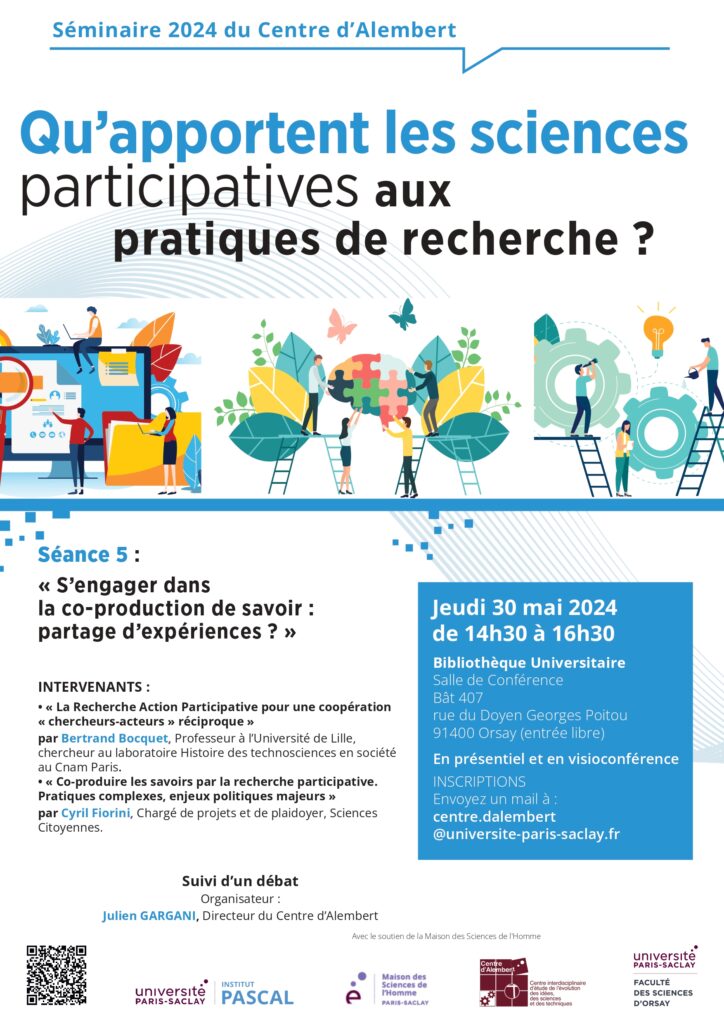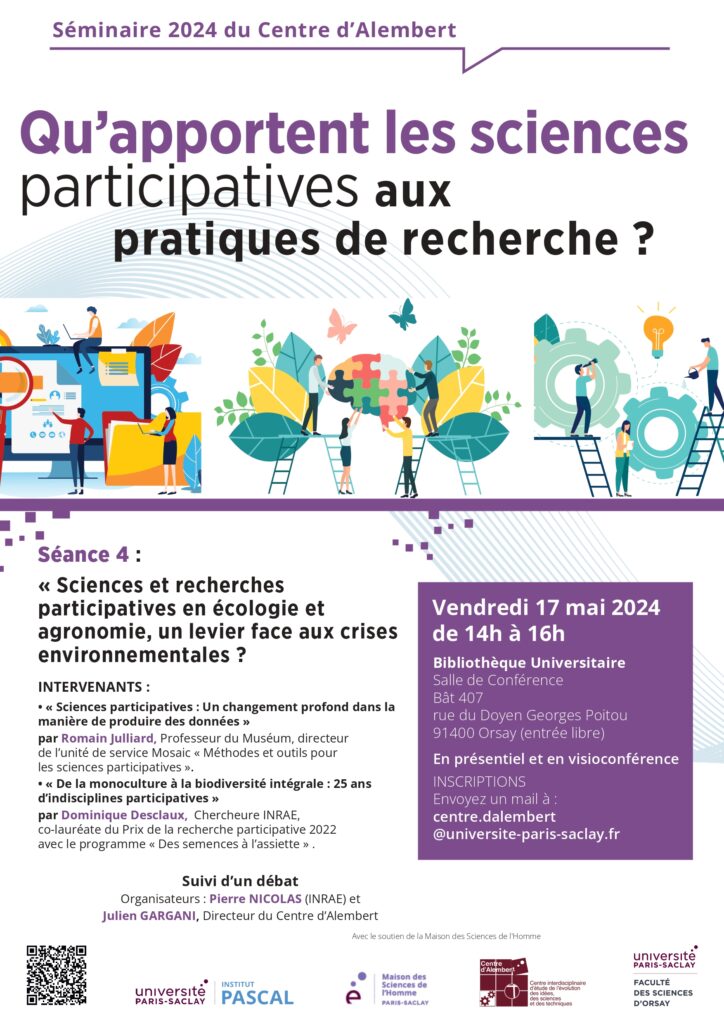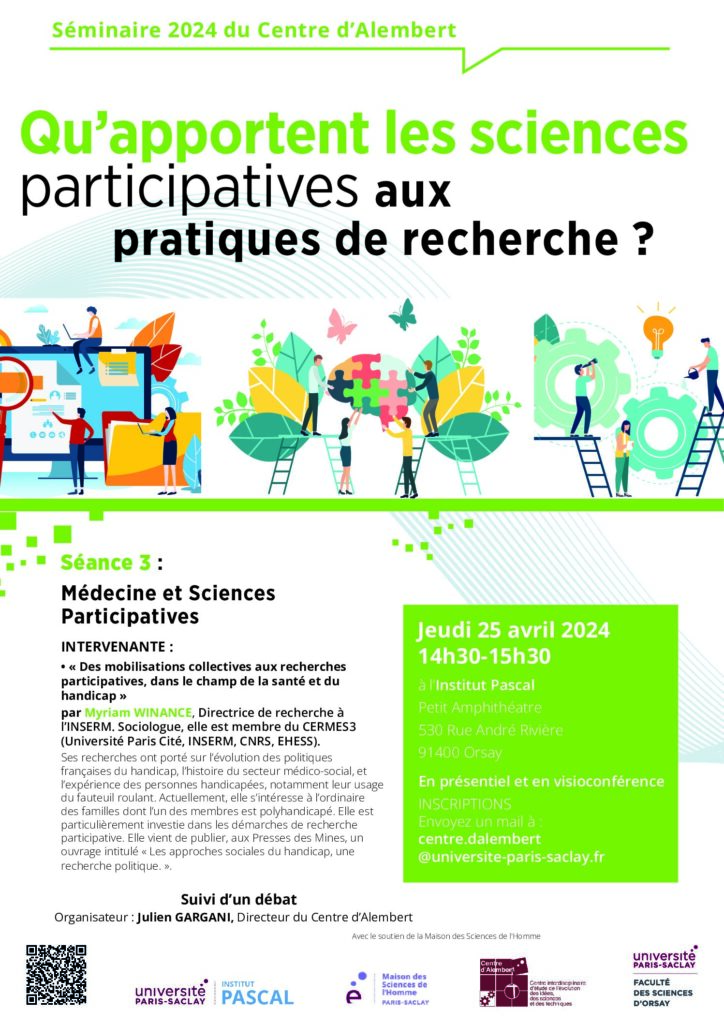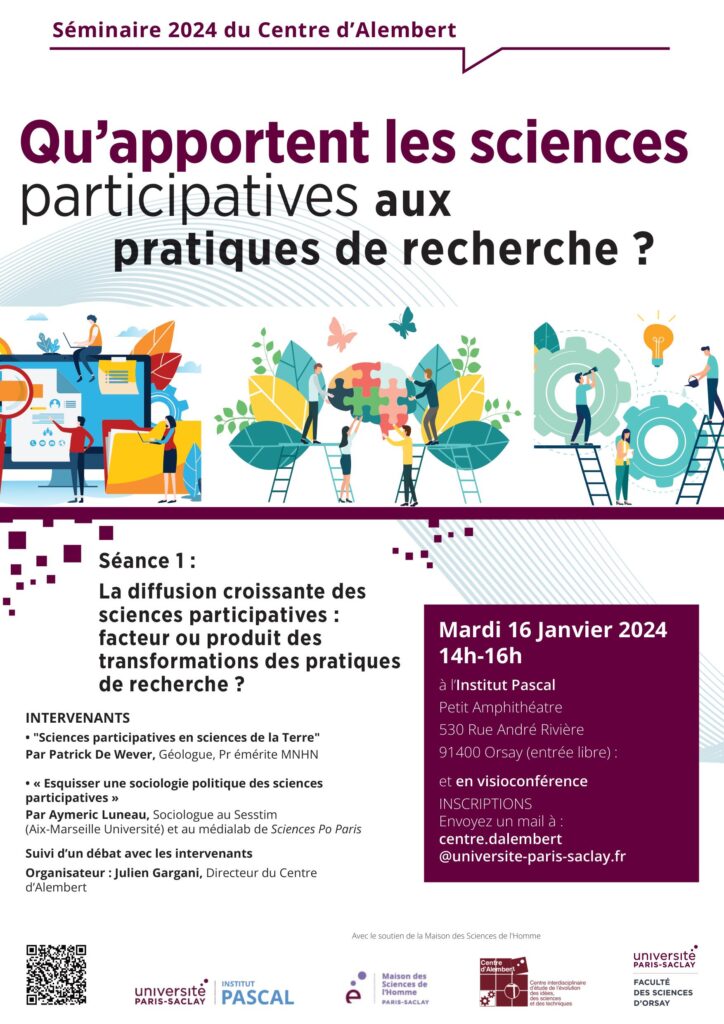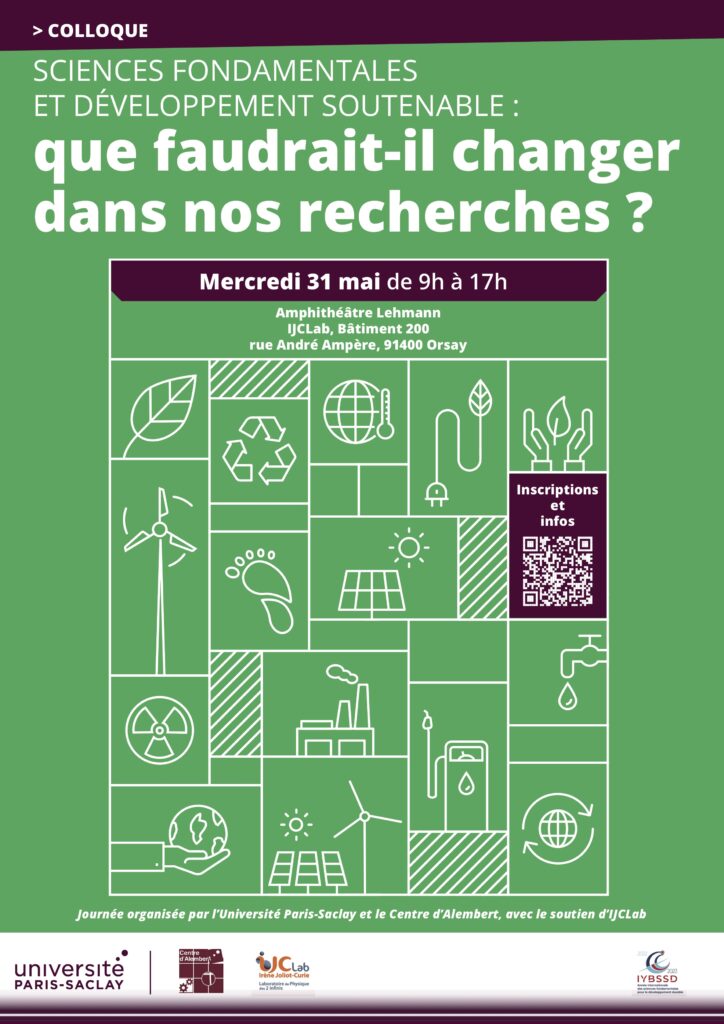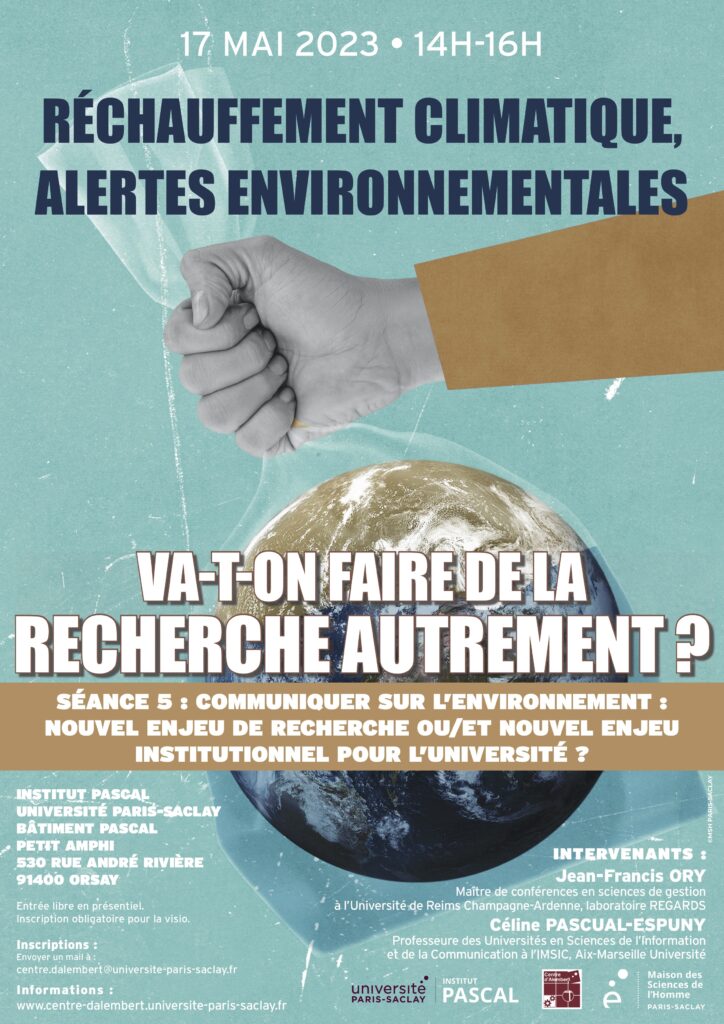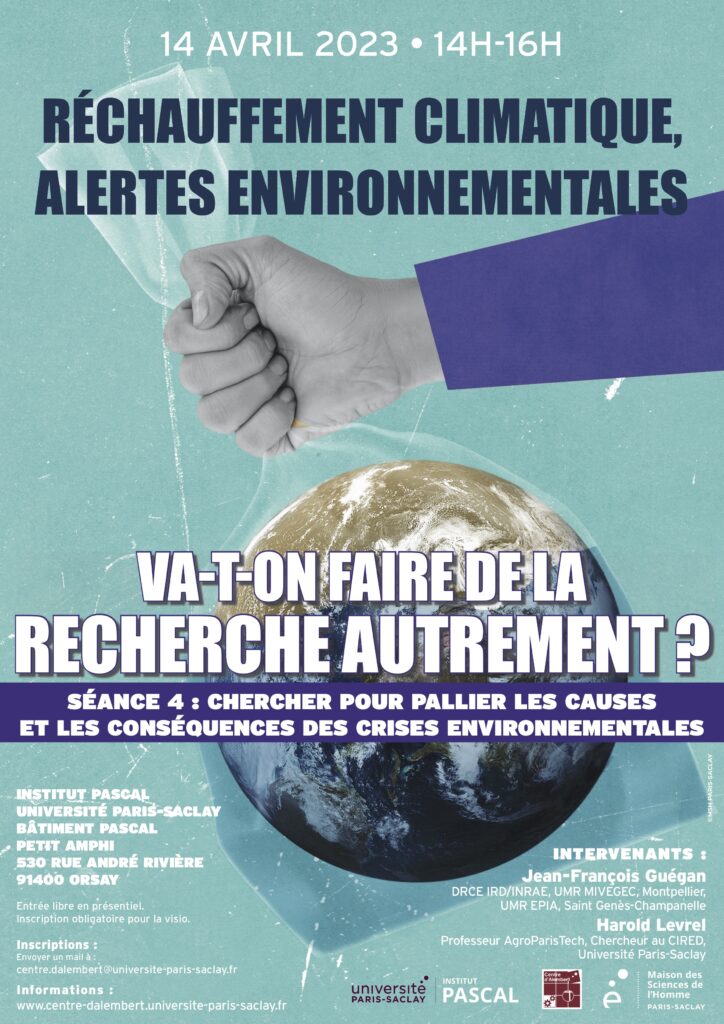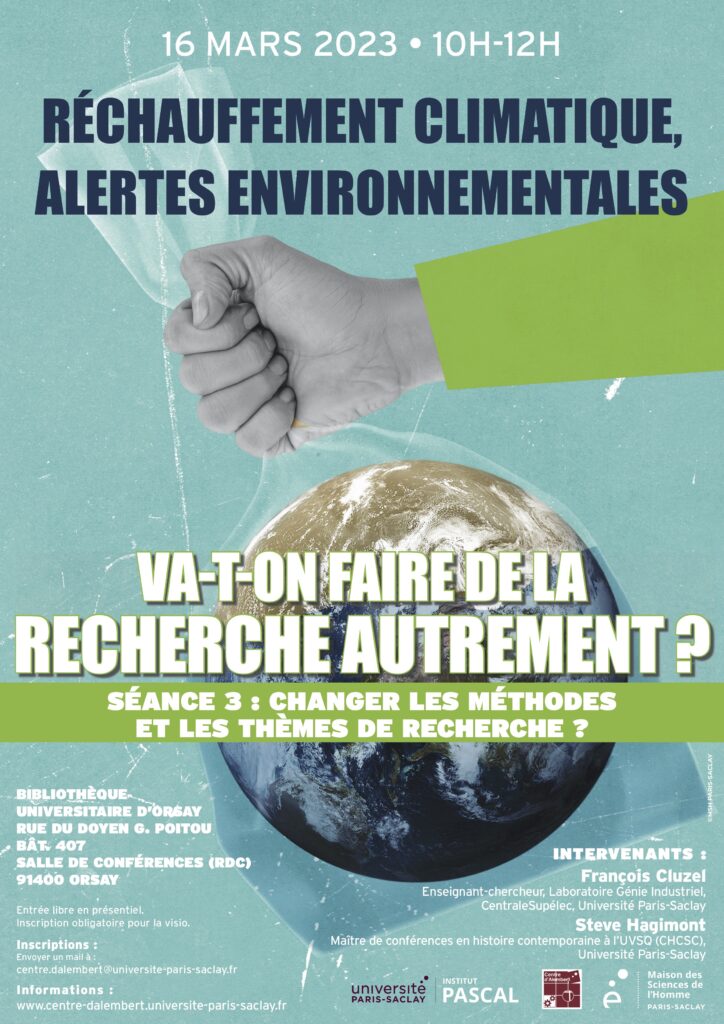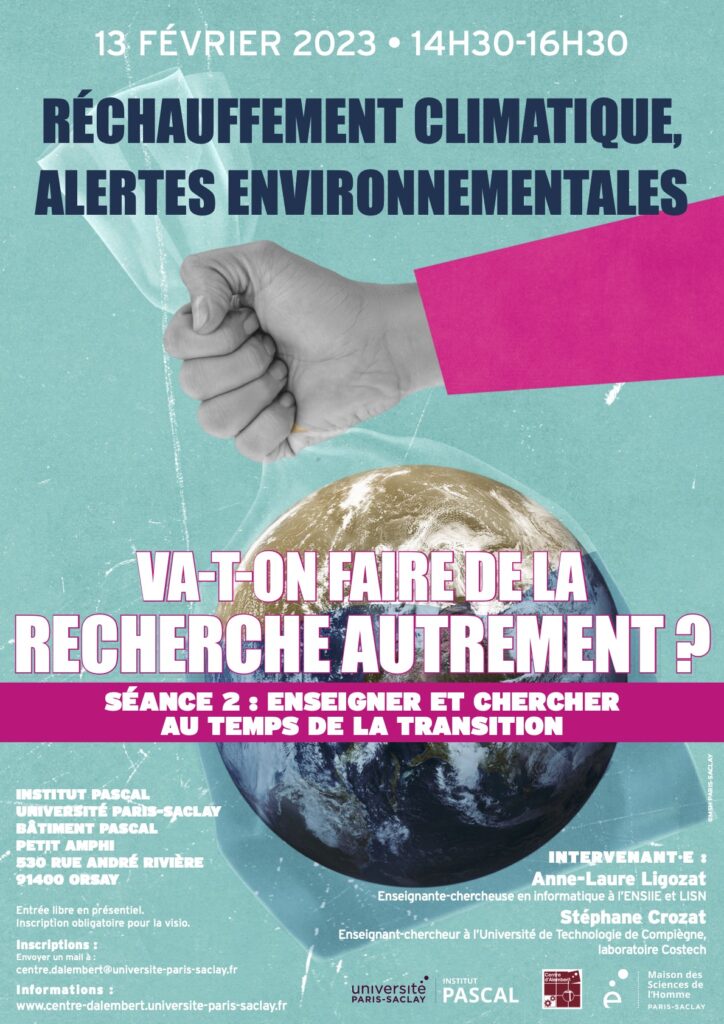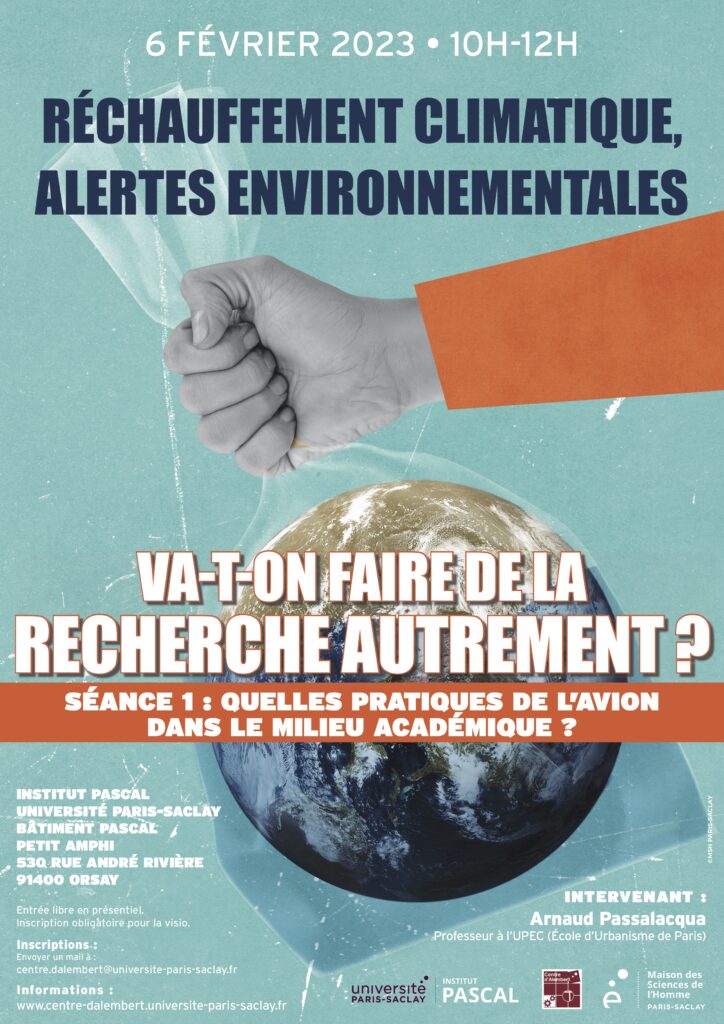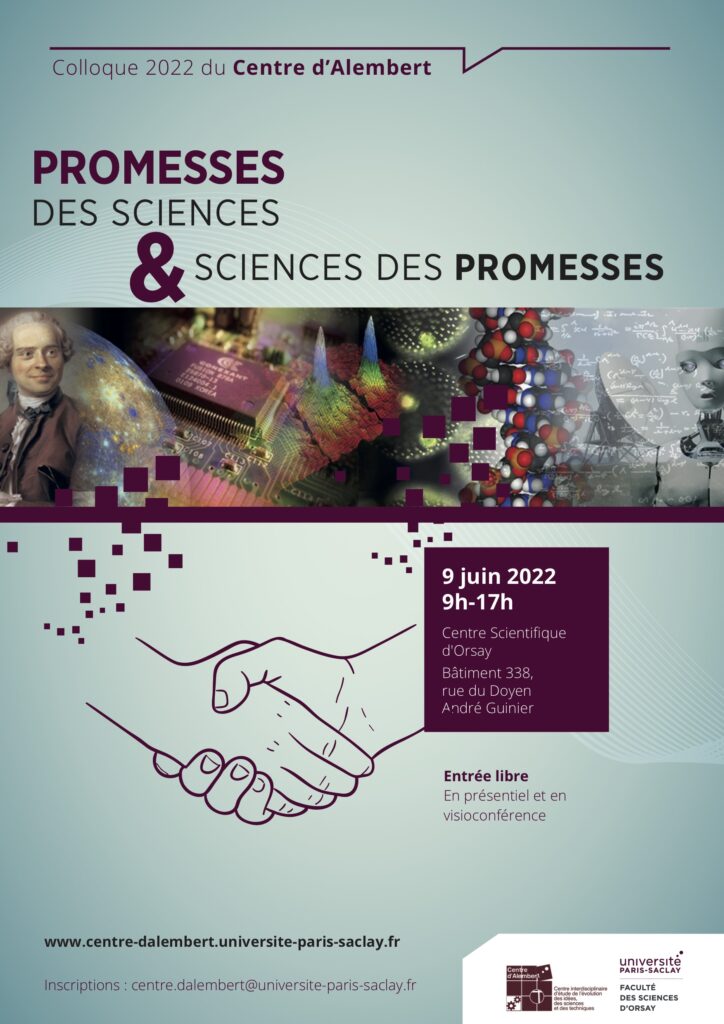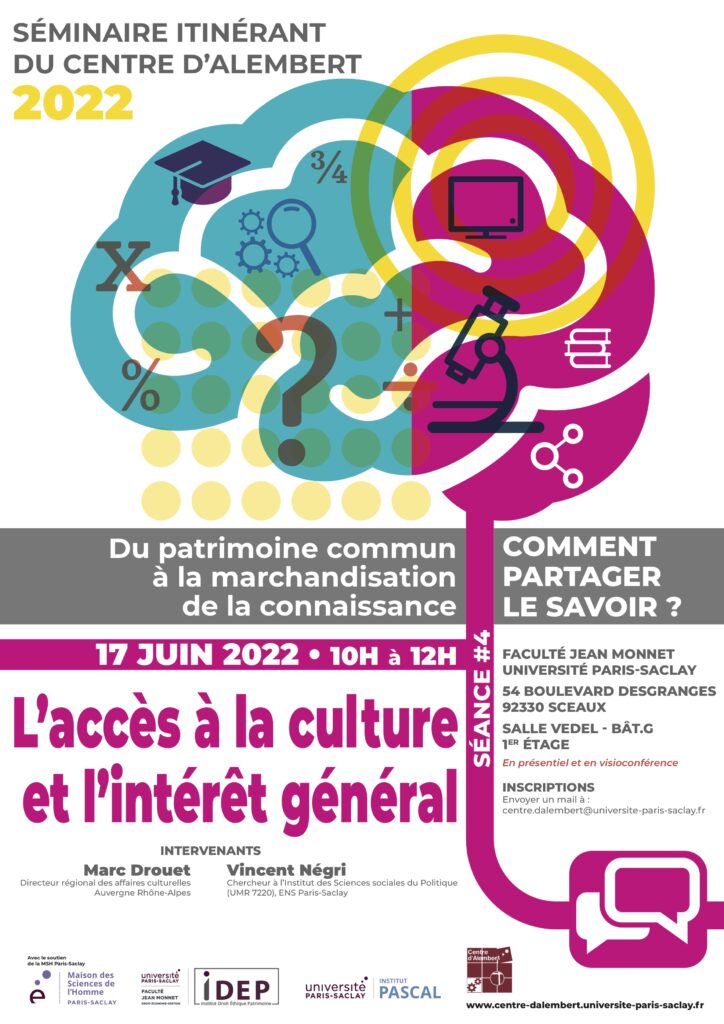Séminaire 2025
Penser et agir autrement avec l’Intelligence Artificielle ?
Les questions soulevées pendant ce séminaire sont organisées en six séances de février à juin.
Séance 4 : 29 avril de 14h à 16h
L’IA est-elle discriminante :
Sexisme, racisme, inégalités ?
Présentations de Patrice Bertail et Pauline Gourlet suivies d’un débat animé par Hélène Gispert, Université Paris Saclay, Samuel Roturier, UVSQ et Julien Gargani, Directeur du Centre d’Alembert.
Inscription obligatoire, en présentiel ou en distanciel.
Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur le contenu de la séance, veuillez consulter le lien suivant : https://seminaire-ia-4.sciencesconf.org/
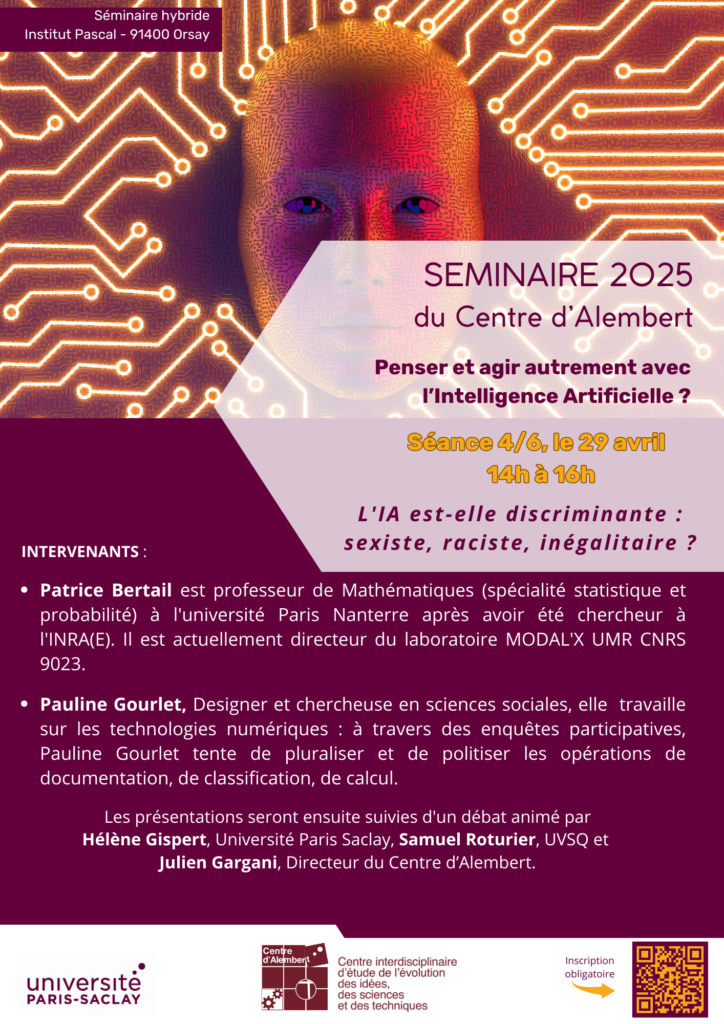
Patrice Bertail est professeur de Mathématiques (spécialité statistique et probabilité) à l’université Paris Nanterre après avoir été chercheur à l’INRA(E). Il est actuellement directeur du laboratoire MODAL’X UMR CNRS 9023. Il a enseigné dans de nombreux pays, dont les États-Unis, Hong-Kong, le Bénin, la Côte d’Ivoire, Cuba etc… Ses travaux de recherche portent sur les méthodes de statistiques non-paramétriques et les méthodes de rééchantillonnage, les processus empiriques, les chaînes de Markov et l’apprentissage statistique. Il a également réalisé des travaux plus appliqués sur l’évaluation des risques alimentaires. Ses travaux récents portent surtout sur l’apprentissage statistique et l’IA dans un cadre dépendant et les corrections de biais dans ce cadre.
Biais en apprentissage statistique : une revue et une approche
semi-paramétrique par calibration
Résumé:
Dans cette présentation, nous passons d’abord en revue quelques types de biais pouvant apparaître fréquemment dans des problèmes d’apprentissage statistique : biais de données, biais de sélection, biais d’endogénéité, biais de modèle dans les cas non-stationnaires, biais cognitifs etc… Ces types de biais sont bien connus dans la littérature statistique et plus encore en économétrie mais pas toujours pris en compte en apprentissage. Ces problèmes de biais posent non seulement des problèmes techniques mais aussi éthiques comme nous le verrons sur quelques exemples. Les techniques de corrections de biais sont souvent inspirées de technique de sondage et reposent sur des pondérations adéquates des individus : Vardi dans les année 80’s a même donné des conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir corriger de biais (essentiellement de sélection ou d’endogénéité) en présence d’information transversales et/ou marginales. Nous nous intéressons dans une seconde partie au problème de l’apprentissage par transfert (« Transfert Learning ») et montrons comment l’incorporation d’un modèle semi-paramétrique permet de corriger des biais à partir de l’observation de quelques moments : l’idée est très proche de la calibration ou du calage sur marge en sondage, les poids permettant de correctement repondérer les risques.
Pauline Gourlet, Chercheuse associée au médialab de Sciences Po et co-fondatrice du collectif de design L’atelier des chercheurs, Pauline Gourlet travaille à l’intersection de la recherche en design, de l’ergonomie et des STS (études des sciences et des techniques). Ses travaux portent sur le développement situé de dispositifs numériques dont elle étudie les effets, notamment sur l’action collective et les processus décisionnels. Au cours de recherches-actions réalisées dans des contextes variés (de l’école primaire aux Nations-Unies), elle expérimente des dispositifs d’enquêtes participatives et des pratiques collectives de description, en vue de pluraliser et de politiser les problèmes de la numérisation, du calcul et des modes de documentation.
Racisme, sexisme et inégalités : IA et dépossession
Résumé:
Poser la question des « bonnes manières » de calculer pour prévenir toute forme de discrimination est évidemment nécessaire et ce problème a toute sa place dans les conversations sur les développements de l’IA. Mais cette critique interne du système technique se fait souvent au détriment de — même, tend à rendre inaudible — une autre conversation : celle des conditions d’existence des techniques computationnelles. L’enjeu de cette présentation sera de montrer en quoi les développements de l’IA reposent sur des mécanismes de dépossession et perpétuent une organisation sociale raciste, sexiste et largement inégalitaire. Inspirée notamment par les théories féministes de la reproduction sociale, je décrirai trois opérations pour décaler les problèmes de « l’IA », avec un objectif proprement génératif : celui de ré-ouvrir des options de développement technique qui se soucient du renouvellement du monde et de la justice.
Séances précédentes du Séminaire 2025
Séance 3 : 31 mars de 10h à 12h
Impact de l’IA sur la recherche en médecine
Information sur la séance : https://seminaire-ia-3.sciencesconf.org/

Inscription séance 3 : https://seminaire-ia-3.sciencesconf.org/
Séance 2 : 18 mars de 14h à 16h
Impact de l’IA sur le travail
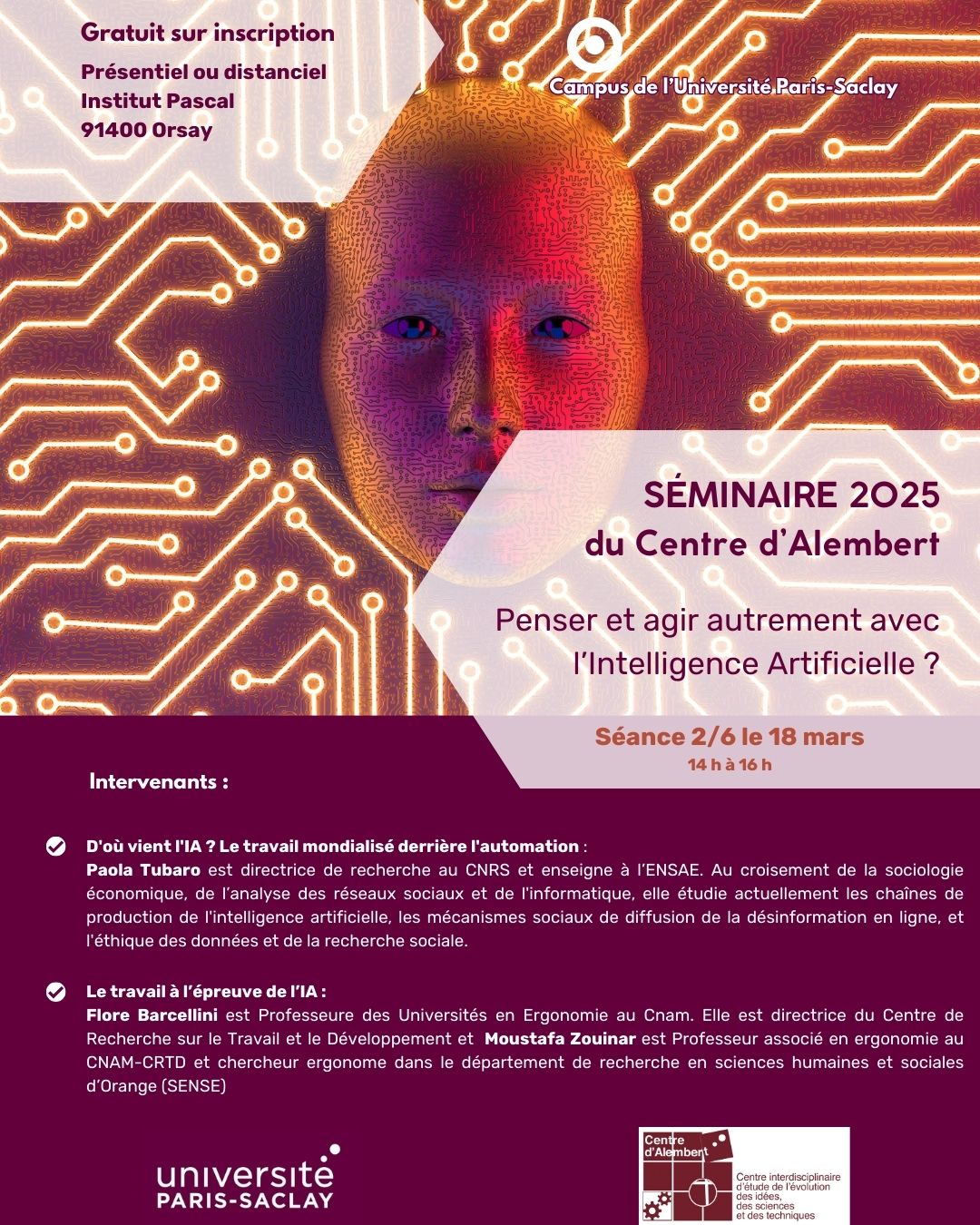
Inscription : https://seminaire-ia-2.sciencesconf.org
Intervenants :
Paola Tubaro est directrice de recherche au CNRS et enseigne à l’ENSAE. Au croisement de la sociologie économique, de l’analyse des réseaux sociaux et de l’informatique, elle étudie actuellement les chaînes de production de l’intelligence artificielle, les mécanismes sociaux de diffusion de la désinformation en ligne, et l’éthique des données et de la recherche sociale.
D’où vient l’IA ? Le travail mondialisé derrière l’automation
Le travail joue un rôle majeur, bien que largement méconnu, dans le développement de l’intelligence artificielle (IA). Les algorithmes d’apprentissage automatique reposent sur des processus à forte intensité de données qui font appel à des humains pour exécuter des tâches répétitives et difficiles à automatiser, et pourtant essentielles, telles que l’étiquetage d’images, le tri d’éléments dans des listes et la transcription de fichiers audio. Des réseaux de sous-traitants recrutent des « travailleurs de la donnée » pour exécuter ces tâches, souvent dans des pays à faible revenu où les marchés du travail stagnent et l’économie informelle domine. Nous regarderons de plus près les conditions de travail et les profils des travailleurs et travailleuses de la donnée au Brésil, au Venezuela, et à Madagascar. Les chaînes d’approvisionnement mondialisées qui relient ces travailleurs et travailleuses aux principaux sites de production de l’IA prolongent les dépendances économiques de l’époque coloniale et renforcent les inégalités héritées du passé.
Flore Barcellini est Professeure des Universités en Ergonomie au Cnam. Elle est directrice du Centre de Recherche sur le Travail et le Développement. Elle a coordonné le rapport « Le travail et l’emploi à l’épreuve de l’IA : Etat des lieux et analyse critique de la littérature » dans le cadre d’un contrat de recherche avec la CGT-FO dans le cadre de l’agence d’objectifs de l’Institut de Recherche Economique et Sociale (https://ires.fr/publications/cgt-fo/le-travail-et-lemploi-a-lepreuve-de-lia-etat-des-lieux-et-analyse-critique-de-la-litterature/).
Moustafa Zouinar est Professeur associé en ergonomie au CNAM-CRTD et chercheur ergonome dans le département de recherche en sciences humaines et sociales d’Orange (SENSE), Moustafa Zouinar mène des recherches autour de : l’analyse des usages de dispositifs techniques numériques dans des contextes variés et des transformations occasionnés par ces usages sur le plan de l’activité, l’interaction Humain-machine, et la conception des systèmes interactifs. Actuellement, ses travaux portent principalement sur les Systèmes d’Intelligence Artificielle, leur déploiement et usages dans les milieux professionnels, leurs conséquences sur le travail, et leur conception.
Le travail à l’épreuve de l’IA.
Flore Barcellini et Moustafa Zouinar présenteront une analyse critique des discours et des recherches en cours sur les transformations du travail permettant de dépasser les discours simplistes sur les bénéfices de l’automatisation dans le contexte du développement de l’IA dans les milieux de travail. Cette analyse reviendra sur certains bénéfices de l’IA en termes de gain de performance, les transformations constatées qui seront complétées par une mise en garde sur les effets contre-productifs et les risques de l’IA pour le travail (complexification du travail, incertitude, augmentation de la charge de travail, subordination accrue, baisse de la fiabilité des actions, perte de sens du travail, diminution de la créativité et d’uniformisation de la pensée et des produits, perte du développement de compétences et de l’expertise, etc.). Elle mettra en lumière l’importance cruciale des choix organisationnels et de la participation des travailleurs dans le déploiement de l’IA en soulignant que les effets des usages de l’IA sur le travail ne sont pas prédéterminés, mais dépendent largement des décisions prises par les entreprises/institutions et les acteurs sociaux et de la valeur qui est donné à l’expérience des professionnels et au travail réel. Pour conclure, les auteurs préconiseront une approche basée sur quatre piliers pour développer des usages soutenables de l’IA, favorables au travail et aux salariés: le développement de la capacité d’apprentissage des organisations, un dialogue social renouvelé, des conduites de projet participatives et donnant une valeur à l’expérience des professionnels, et l’organisation et la documentation des expérimentations d’usage in situ des SIA.
Séance 1 : 13 Février de 14h à 16h
Qu’est-ce que l’IA ? Définition et matérialité
Intervenants :
Daniel Andler, est professeur émérite de l’Université de la Sorbonne, il a été titulaire de la chaire de philosophie des sciences et d’épistémologie de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Il travaille au Département d’études cognitives qu’il a fondé à l’Ecole normale supérieure en 2001. Il est membre honoraire de l’Institut universitaire de France. En décembre 2016, il a été élu à l’Académie des sciences morales et politiques.
L’intelligence artificielle : ce qu’elle vise, ce qu’elle fait
Après avoir connu des hauts et des bas, l’intelligence artificielle semble inscrite désormais sur une trajectoire victorieuse : rien ne semble pouvoir lui échapper. Non seulement elle conquiert, l’un après l’autre, des domaines — les échecs, le jeu de go, la science, l’organisation du quotidien, la gestion des villes, la diffusion de l’information, l’art de la guerre — qui ont longtemps semblé réservés à l’intelligence humaine, mais avec ChatGPT et l’IA générative, elle semble en mesure de la rattraper d’un coup d’un seul.
L’intelligence artificielle oscille depuis l’origine entre trois conceptions. Selon la première, aujourd’hui minoritaire, elle est liée à l’intelligence humaine à la manière dont une copie est liée à ce dont elle est copie ; selon la deuxième, plus largement acceptée, elle n’a pour ambition que de se substituer peu à peu à l’intelligence humaine, permettant peut-être à terme de s’en passer complètement. Ces conceptions reposent sur une méprise : les produits de l’IA n’appartiennent pas à la même catégorie d’entités que l’intelligence humaine. Ils sont impressionnants, ils peuvent être utiles et dangereux. Mais ce sont des outils, ce ne seront jamais des collègues : cette troisième conception nous met à l’abri d’illusions qui constituent elles-mêmes un danger.
Fabrice Flipo est professeur de philosophie, travaillant dans le domaine des sustainability studies. Il est chercheur au Laboratoire de Changement Social de l’Université de Paris Cité. Il s’intéresse notamment aux infrastructures écologiques du numérique, avec Peut-on croire aux TIC vertes ? (Presses des Mines, 2009), L’impératif de la sobriété numérique (Matériologiques, 2020).
Écologie de l’infrastructure numérique
Alors que Google avait un objectif de neutralité carbone, l’IA a fait grimper ses émissions de 50%. Le secteur du numérique est aujourd’hui celui qui a la pire trajectoire de tous, en termes de GES. Il pourrait tripler ses émissions d’ici 25 ans, voire davantage si l’efficacité énergétique ralentit. Alors que les catastrophes climatiques se multiplient, l’intervention brossera un tableau rapide de la situation, en posant une question : les « bienfaits » de l’IA valent-ils réellement le coût ainsi engagé ?
Débat animé par Julien Gargani, Directeur du Centre d’Alembert et Guillaume Roux, Maître de conférence en Physique, Université Paris-Saclay.
Événements passés
Colloque du 12 novembre 2024 :
Les scientifiques face aux guerres : neutralité, engagement, empêchement
Colloque organisé par L’Université Paris-Saclay et le Centre d’Alembert
le 12 novembre 2024 de 9h30 à 17h
En présentiel et en distanciel
IJCLab – Auditorium Irène Joliot-Curie
Domaine de l’Université Paris-Saclay
91400 Orsay
Programme et inscription ici
♦ Séminaire 2024 :
Qu’apportent les sciences participatives aux pratiques de la recherche
Séance 5 : 30 mai 2024
L’université Paris-Saclay, le Centre d’Alembert Organisent un séminaire
Jeudi 30 mai 2024
14h30 à 16h30
Séance 5 « S’engager dans la co-production
de savoir : partage d’expériences »
A la Bibliothèque Universitaire
rue du Doyen Georges Poitou
Salle de Conférences
91400 Orsay
En présentiel et en visioconférence
Contact & Inscription :
centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr
Séance 4 : 17 mai 2024
L’université Paris-Saclay, le Centre d’Alembert
organisent un séminaire
Vendredi 17 mai 2024
de 14h à 16h
Séance 4 : Sciences et recherches participatives en écologie et agronomie, un levier face aux crises environnementales ?
A la Bibliothèque Universitaire – Bât 407 rue du Doyen Georges Poitou – Salle de Conférences (RdC)
91400 Orsay
En présentiel et en visioconférence
Contact & Inscription :
centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr
Séance 3 : 25 avril 2024
L’Université Paris-Saclay, le Centre d’Alembert
organisent un séminaire
Lundi 25 avril 2024
de 14h30 à 15h30
Séance 3
à l’Institut Pascal
Petit Amphithéâtre
530 Rue André Rivière 91400 Orsay
Plan d’accès
En présentiel et en visioconférence
INSCRIPTIONS
Envoyer un mail à :
centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr
ou s’inscrire via Eventbrite
Séance 2 : 18 mars 2024
L’Université Paris-Saclay, le Centre d’Alembert
organisent un séminaire
Lundi 18 mars 2024
de 14h30 à 16h30
Séance 2 : Sciences participatives
et patrimoine
à l’Institut Pascal
Grand Amphithéâtre
530 Rue André Rivière 91400 Orsay
Plan d’accès
En présentiel et en visioconférence
INSCRIPTIONS
Envoyer un mail à : centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr
Contact et informations
Séance 1 : 16 janvier 2024
L’Université Paris-Saclay, le Centre d’Alembert
organisent un séminaire
Mardi 16 janvier 2024 de 14h à 16h
Séance 1 : La diffusion croissante des sciences participatives : facteur ou produit des transformations des pratiques de recherche ?
à l’Institut Pascal – Petit Amphithéâtre
530 Rue André Rivière 91400 Orsay
Entrée Libre
Plan d’accès
et en visioconférence : s’inscrire ici
Contact et informations
♦ Colloque 31 mai 2023 :
Sciences fondamentales et développement soutenable : que faudrait-il changer dans nos recherches ?
L’Université Paris-Saclay, le Centre d’Alembert
organisent un colloque le 31 mai 2023 de 9h à 17h, sur le thème :
Sciences fondamentales et développement soutenable : que faudrait-il changer dans nos recherches ?
Amphi Lehmann, bâtiment 200, rue André Ampère, Orsay Choose from popular casino classics such as blackjack, roulette or jackpot 888 slots.
♦ Séminaire 2023 :
Réchauffement climatique, alertes environnementales : va-t-on faire de la recherche autrement ?
17 mai 2023
Voir les vidéos
Séance 4 :
Chercher pour pallier les causes et les conséquences des crises environnementales
14 avril 2023
Voir les vidéos
Jean-François Guégan, Directeur de Recherche de classe exceptionnelle IRD/INRAE, UMR MIVEGEC, Montpellier, UMR EPIA, Saint Genès-Champanelle
Changements climatiques et maladies infectieuses : Aiôn et Khronos, juges du temps de la recherche
et
Harold Levrel, Professeur AgroParisTech, Chercheur au CIRED, Université Paris-Saclay.
Vers une économie de la coévolution ?
Séance 3 : Changer les méthodes et les thèmes de recherche ?
16 mars 2023
François Cluzel, enseignant-chercheur, Laboratoire Génie Industriel, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay : Quels leviers d’action du chercheur pour minimiser l’impact environnemental de ses activités ?
et
Steve Hagimont, maître de conférences en histoire contemporaine à l’UVSQ, Université Paris-Saclay : Du passé, faire table-rase ? Réflexions pratiques et épistémologiques sur l’histoire à l’heure des changements globaux.
Séance 2 : Enseigner et chercher autrement au temps de la transition
13 février 2023
Voir les vidéos
Stéphane Crozat, enseignant-chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne, laboratoire Costech (informatique)
La « low-technicisation », une piste pour concilier technologies et transitions ?
Anne-Laure Ligozat, enseignante-chercheuse en informatique à l’ENSIIE et LISN (Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique)
La recherche en informatique face aux crises environnementales.
Séance 1 : Quelles pratiques dans le milieu académique ?
6 février 2023
Voir les vidéos
Arnaud Passalacqua, Professeur à l’UPEC (École d’urbanisme de Paris), chercheur au Lab’Urba et chercheur associé au LIED.
Quelles pratiques de l’avion dans le milieu académique ?
Antoine Hardy, Doctorant en science politique, Centre Emile-Durkheim (en visioconférence)
Le changement climatique change-t-il la recherche ?
Présentation du séminaire :
Autour d’une question qui fait l’actualité, le Centre d’Alembert interrogera différentes disciplines du périmètre Paris-Saclay comme l’informatique, l’histoire, la biologie/médecine, la physique/chimie, les sciences de la communication, la géographie/agronomie,…
Notre série de séminaires sera articulée avec une conférence en relation avec l’Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable.
Depuis plusieurs décennies, les problématiques environnementales sont documentées dans des études académiques et produisent des effets notables sur nos sociétés. Alors que les épisodes de sécheresse, d’inondation ou de canicule affectent notre quotidien et qu’émerge une volonté de trouver des solutions chez de nombreuses personnes, la mobilisation de l’enseignement supérieur et de la recherche est hétérogène. L’intérêt croissant du monde académique pour l’environnement n’est-il qu’un affichage où chacun continue de faire les choses comme avant ? Pourtant, de nouvelles pratiques et de nouvelles thématiques de recherche voient le jour. Est-ce le prélude, à une transformation en profondeur des activités de recherche ?
Du bilan carbone des laboratoires au tri des déchets en passant par la réduction volontaire des déplacements en avion, les initiatives locales se multiplient et une éthique environnementale spontanée de la recherche voit le jour. Mais jusqu’où ces préoccupations vont-elles influencer les petits gestes quotidiens et les pratiques scientifiques fondamentales des chercheurs ? Du choix des thématiques de recherche à la modification des expériences et des équipements, qu’est-ce que cela peut changer ? Peut-on ou doit-on faire nos recherches en étant plus sobres ? Y a-t-il un risque d’utiliser la réduction de notre empreinte environnementale pour réduire le financement de la recherche ?
♦ Séminaire 2022 :
Du patrimoine commun à la marchandisation de la connaissance : comment partager le savoir ?
Les vidéos des séances sont en ligne et accessibles ICI
Séance 5 :
Ressources naturelles et patrimoine commun
20 octobre 2022
14h – 16h
Petit amphi – Bâtiment Pascal
Bâtiment 530 rue André Rivière – Orsay
Accès
Présentation de la séance
En présentiel et en visioconférence
Contact et Inscriptions : centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr
Interventants :
Isabelle Rouget, paléontologue, Professeure au Muséum national d’Histoire naturelle, UMR CR2P.
Bruno Romagny, économiste, Directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement, UMR LPED.
♦ Colloque 9 juin 2022 :
Promesses des sciences et sciences des promesses
Les vidéos du colloque sont en ligne et accessibles ICI
9 juin 2022 – 9h -17h
Présentation détaillée du colloque
Université Paris-Saclay,
Centre scientifique d’Orsay
338 rue du Doyen André Guinier
Salle de conférence (1er étage)
Renseignements et inscriptions :
centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr
♦ Séminaire 2022 :
Du patrimoine commun à la marchandisation de la connaissance : comment partager le savoir ?
Séance 4 :
L’accès à la culture et l’intérêt général
17 juin 2022
10h – 12h
Faculté Jean Monnet
54 boulevard Desgranges
92230 Sceaux
Salle Vedel, bâtiment G (1er étage)
Accès
En présentiel et en visioconférence
Contact et Inscriptions : centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr
Intervenants :
Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes
Vincent Négri, chercheur à l’Institut des Sciences sociales du Politique (UMR 7220), ENS Paris-Saclay
31 mai 2022
14h – 16h
Bibliothèque Universitaire, bâtiment 407 rue du Doyen Georges Poitou, Orsay
Salle de conférences (RdC)
En présentiel et en visioconférence
Contact et Inscriptions : centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr
Intervenants :
Lise Verlaet
Directrice de l’Institut des Technosciences de l’Information et de la Communication, Université Paul-Valéry, Responsable scientifique du programme de recherche-action NumeRev (MSH-Sud)
Arnaud Saint-Martin,
Sociologue, Chargé de recherche au CNRS, CESSP Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CNRS, Paris 1, EHESS)
Séance 2 :
La Mathématique comme Science Ouverte libre à travers l’Histoire : le rôle-clé des bibliothèques
11 avril 2022
16h30 – 19h
Amphi Yoccoz, Institut de Mathématique d’Orsay, Bâtiment 307 rue Michel Magat
Présentation de la séance
En présentiel et en visioconférence
Contact et Inscriptions : centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr
Intervenants
Elisabeth Kneller,
Ingénieure de recherche, responsable de la Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard et responsable du réseau RNBM (réseau national des bibliothèques de mathématiques)
Joël Merker,
Professeur, Institut de Mathématique d’Orsay, Université Paris-Saclay
22 mars 2022
10h – 12h
Grand amphi, Institut Pascal, 530, rue André Rivière, Orsay
En présentiel et en visioconférence
Présentation de la séance
Intervenants :
Frédéric Thomas
Chargé de recherche IRD, Histoire des sciences, Histoire environnementale
UMR Savoirs Environnement Sociétés (IRD, CIRAD, Université Paul-Valéry Montpellier)
Amandine Cornille
Chargée de recherche CNRS, Laboratoire Génétique quantitative et évolution – Le Moulon
Institut Diversité Ecologie et Evolution du Vivant (IDEEV)
(CNRS/ INRAE/ AgroSup/ Université Paris-Saclay)
Présentation du séminaire 2022 :
Une partie du monde académique met à disposition ses productions : conférences ouvertes, logiciels libres, données en libre accès, publications en accès libre. Parallèlement, le financement des recherches académiques par des entreprises, l’implication de celles-ci dans les formations universitaires, le dépôt de brevets, l’économie de l’édition et de la formation tendent à placer l’enseignement et la recherche dans une économie du savoir « marchande » avec des contraintes spécifiques. Le mélange de gratuité et de monétarisation, de partage et de marchandisation, d’altruisme et d’individualisme, est-il nécessaire au fonctionnement de la science actuelle ou pénalisant ? Quel modèle d’économie de la connaissance est le plus profitable à tous ? La science « ouverte » est-elle l’institutionnalisation du partage ou la mise à disposition à bas coûts des productions scientifiques pour le secteur marchand ? Comment les différentes communautés disciplinaires articulent-elles la production de biens communs et la valorisation de leurs découvertes ?
♦ Colloque 2021 : Vérités scientifiques et enjeux sociaux
Jeudi 27 mai 2021
9h30 -17h30
En visioconférence
Présentation du colloque et PROGRAMME
Les vidéos sont en ligne.
♦ Notre thématique de l’année :
Qu’est-ce qu’un fait établi ? Comment se trompe-t-on ?
La remise en cause de « faits » établis dans le monde académique pose la question des critères de validation et des méthodes d’établissement des faits. Y a-t-il une méthode universelle pour dire ce qui est vrai ou chaque discipline a-t-elle ses propres critères spécifiques pour décider des limites des énoncés acceptables ? Est-ce que la façon d’établir les faits ou la manière de les énoncer a changé ? Nous souhaitons faire le point sur ce qu’est un fait établi dans différentes disciplines. A travers l’organisation d’une série de séminaires dans différentes disciplines, le séminaire itinérant du Centre d’Alembert permettra d’interroger la légitimité et la fécondité du doute ainsi que ses limites à l’heure des « faits alternatifs » et des manipulations de l’information sur des sujets traités dans le monde académique.
Mardi 4 mai 2021 – 14h-16h
Intervenants :
Pr Jean-Christophe Thalabard
Professeur émérite à la faculté de santé de l’Université de Paris, membre du laboratoire
MAP5 (Mathématiques Appliquées à Paris 5), UMR CNRS
Pr Elie Azria
Professeur de Gynécologie Obstétrique à l’Université de Paris, Chef de service de la maternité Notre Dame de Bon Secours du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph,
Chercheur en épidémiologie au sein de l’équipe « Épidémiologie Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique » (EPOPé)
Voir la vidéo...
Séance 7 :
Qu’est-ce que valider un fait en économie ? En quoi la théorie est-elle utile dans ce but ?
Jeudi 8 avril 2021
Intervenantes :
Ariane Dupont-Kieffer
Historienne de la pensée économique et économiste des transports, Laboratoire PHARE, Université Paris 1
Agnès Labrousse
CRIISEA (Centre de recherche sur l’industrie, les institutions et les systèmes économiques d’Amiens), Université de Picardie – Jules Verne.
Voir la vidéo...
Séance 6 :
Entre amplification et disqualification de la parole scientifique. Les médias font-ils écran ou sont-ils un écran pour la science?
Mardi 9 février 2021
Intervenants :
Jean-François Ternay
Enseignant-Chercheur. Université de Paris. Master Sciences et Médias
Sylvestre Huet
Journaliste scientifique, Blog : http://huet.blog.lemonde.fr/
Voir la vidéo...
Séance 5 :
Comment établit-on un fait en physique?
Mardi 19 janvier 2021
Intervenants :
Florent Robinet
Chercheur au CNRS, IJCLab (Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie), Université Paris-Saclay et
Emanuel Bertrand
Maître de conférences à l’ESPCI Paris-PSL (Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles), Chercheur en histoire des sciences au Centre Alexandre-Koyré (CNRS-EHESS-MNHN)
Voir la vidéo...
Séance 4 :
Qu’est-ce qui fait preuve en mathématiques ? Pratiques de recherche et de publications au XIXe siècle.Lundi 23 mars 2020 Reportée Lundi 23 novembre 2020
Intervenantes :
Emmylou Haffner, Docteure en histoire des mathématiques de l’Université Paris Diderot, post-doctorante au Laboratoire de Mathématiques d’Orsay et
Caroline Ehrhardt, Maitre de conférences en histoire des sciences à l’université Paris 8, membre de l’IDHE-S (UMR 8533)
Voir la vidéo...
Séance 3 :
L’observation permet-elle des découvertes fiables ? l’exemple de l’astrophysique.
Mardi 3 mars 2020
Intervenant :
Marc Ollivier, Astronome, directeur de l’Institut d’Astrophysique Spatiale d’Orsay, Université Paris-Saclay
Voir les vidéos...
Séance 2 :
Éthique et intégrité scientifique dans le domaine biomédical : normes, fiabilité, confiance
Mardi 28 janvier 2020
Intervenants :
Annick Jacq, Microbiologiste, chercheuse au CNRS, Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, Université Paris-Saclay et
Léo Coutellec, Maître de Conférences en épistémologie et éthique des sciences contemporaines, Responsable de l’équipe « Recherches en éthique et épistémologie » (R2E), Université Paris-Saclay, INSERM, CESP U1018 ; Membre du Conseil pour l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique (POLETHIS) et de l’Espace de réflexion éthique Ile-de-France
Voir les vidéos...
Séance 1 :
Qu’est-ce qu’un fait en sciences du climat ?
Jeudi 21 novembre 2019
Intervenants :
Pascal Yiou, Directeur de Recherche au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement et
Hélène Guillemot, Chercheuse au CNRS, Centre Koyré
Voir les vidéos...
♦ Colloque 2019
La sélection dans le monde académique : pratiques, imaginaire et rationalité

Mercredi 22 mai 2019
Présentation et programme du colloque
Voir les vidéos...
♦ Séminaire 2018-2019
La sélection dans tous ses états : fonctions, processus, conséquences

Présentation du séminaire
Les vidéos des séances sont en ligne
(voir ci-dessous)
Séance 5 :
Big data, IA, sélection des données : causalités, corrélations, conséquences
Jeudi 18 avril 2019
Intervenants :
Diviyan Kalainathan, doctorant, Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI) et
Paola Tubaro, sociologue, CNRS, LRI
Voir les vidéos...
Séance 4 :
La sélection des missions spatiales
aspects techniques, politiques, économiques, conséquences sur la production scientifique
Lundi 25 mars 2019
Intervenants :
Yves Langevin, astrophysicien, directeur de recherche émérite, Institut d’Astrophysique Spatiale et Arnaud Saint-Martin, sociologue, chargé de recherche au CNRS et rattaché au Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS, EHESS, Paris 1)
Voir les vidéos...
Séance 3 :
Coopération et compétition sportives : quelle(s) sélection(s) ?
Mardi 19 mars 2019
Intervenants :
Manuel Schotté, professeur de sociologie, CLERSE – UMR CNRS 8019, Université de Lille
Table ronde avec Anaïs Bohuon, professeure de sociologie, Guillaume Conraud et Ariane Gan, doctorants – CIAMS EA 4532, Université Paris-Sud
Voir les vidéos...
Séance 2 :
La sélection à l’école en France, comment et pour quoi faire.
Mercredi 13 février 2019
Intervenants :
Agnès Van Zanten, sociologue, directrice de recherche CNRS à l’Observatoire Sociologue du Changement, Sciences Po
Renaud d’Enfert, historien de l’enseignement, Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS UMR 7319.
Voir les vidéos...
Séance 1 :
Modeler le vivant : la sélection entre hasard et finalités
Mardi 13 novembre 2018
Intervenants :
Guillaume Achaz, enseignant-chercheur UPMC, Muséum national d’Histoire naturelle et Isabelle Goldringer, chercheuse INRA, Génétique Quantitative et Évolution – Le Moulon
Voir les vidéos...
♦ Notre thématique de l’année :
« La sélection dans tous ses états : fonctions, processus, conséquences »

La sélection semble partout, dans la nature comme dans la société. Elle est souvent présentée comme l’outil idéal pour obtenir la meilleure adéquation entre souhaits et possibilités, besoins et ressources. C’est par la sélection qu’émergerait l’excellence. Est-ce le mode de fonctionnement optimisé de toutes les organisations ou un mode de gestion en situation de pénurie ? S’agit-il d’un processus rationnel pour obtenir des résultats interprétables ou d’une contingence ayant modelé l’évolution des espèces ? Comment fonctionne la sélection et existe-t-il des alternatives ? Nous réfléchirons sur les critères et les méthodes, qu’ils soient automatisés ou non, et au-delà nous interrogerons l’impact de la sélection sur le fonctionnement de nos disciplines scientifiques, sur l’établissement des normes, et sur l’organisation de nos sociétés. Pour cela, le Centre d’Alembert fera intervenir des collègues de différents domaines dans le cadre de ce séminaire : science de l’éducation, sciences de la vie, sciences et techniques des activités physiques et sportives, économie, informatique, physique…
Les séminaires itinérants du Centre d’Alembert
Afin de toucher l’ensemble de la communauté universitaire sur le périmètre Paris-Saclay, tant d’un point de vue disciplinaire que géographique, le Centre d’Alembert propose un « séminaire itinérant ».
Le thème annuel de réflexion du Centre, « La sélection dans tous ses états : fonctions, processus, conséquences », sera décliné en six séminaires, relevant de domaines spécifiques, et traités au sein de différents laboratoires locaux.
♦ Colloque 2018
CATASTROPHES : Prévisions, prévention, précaution
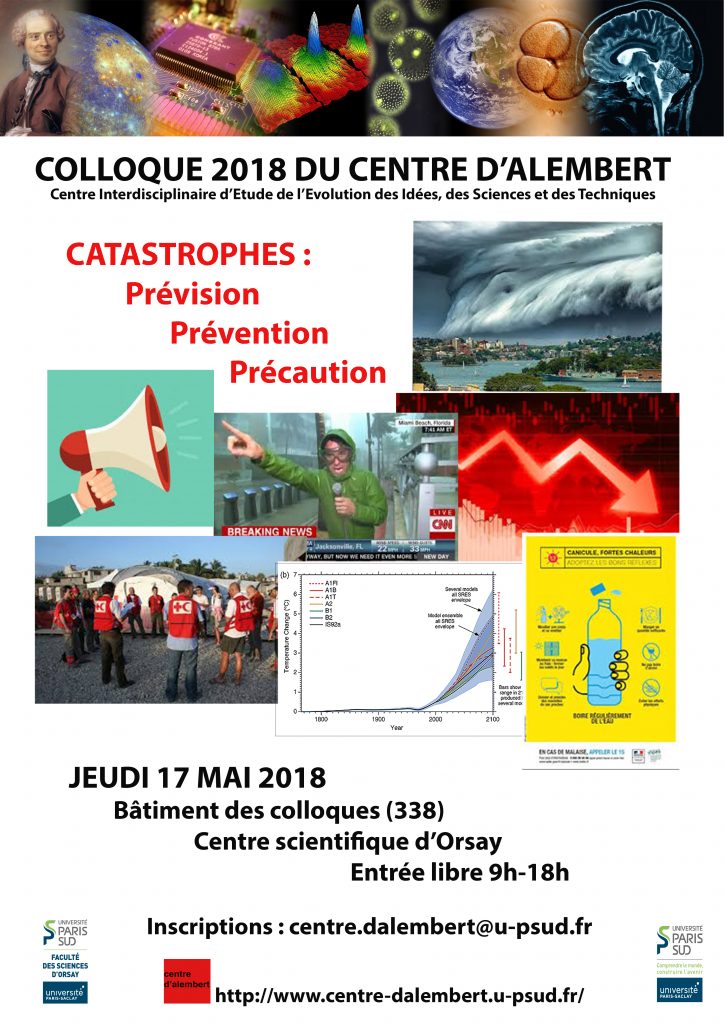
Jeudi 17 mai de 9h à 17h30
Centre scientifique d’Orsay
Cette journée est le prolongement de notre séminaire de cette année.
Programme
Télécharger la plaquette
√ Les vidéos sont en ligne ICI
♦ Séminaire 2017-2018
Prévisions, précautions, préventions, catastrophes

√ Les vidéos des 6 séances sont en ligne ICI
Vous pouvez retrouver les enregistrements des sessions précédentes :
* les séminaires : http://www.centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr/category/seminaires/
* les colloques : http://www.centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr/archives-colloques/